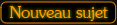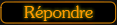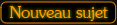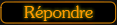Non ce n'est pas du tout dans le sens de prouver que l'homme est un animal comme les autres animaux que j'ai posé mon raisonnement, puisque déjà les animaux entre eux ont des points communs et des différences. C'est dans le sens où l'homme se sert du prétexte de sa suprématie en tant qu'unique être capable de conscience pour justifier ses exploitations sur l'autre animal= tous les autres animaux (et même si cela le fait souffrir alors qu'il serait au moins possible de l'éviter), cet "autre" qui serait sensé en être dépourvu... alors qu'il n'existe pas un autre animal mais de nombreuses espèces...
Et qu'en plus cela sous-entendrait que l'homme, soit, à l'instar des animaux, assez doué de conscience pour faire souffrir l'animal : quelle incohérence !
La polémique sur la conscience était en réponse aux arguments qui ont été postés sur ce topic : grosso modo "l'animal n'a pas de conscience".
Si j'ai l'impression que plus l'homme avance dans ses observations objectives, plus il peut être amené à reconnaitre que les points sur lesquels il croyait pouvoir s'appuyer pour se distinguer en tant qu'animal supérieur s'ébranlent les uns après les autres... je ne pense pas pour autant qu'il devrait en conclure qu'il est un animal
comme les autres (sachant ces "autres" déjà différents entre eux).
Ce serait encore une fois tout ramener à nos pommes d'humains, que nous soyons semblables ou complètement distincts reste une monopolisation de l'anthropocentrisme : il s'agit juste d'accepter et des points communs, et des différences, sans passer par les caricatures réductrices qui nous arrangent et dont nous avons monté un système de croyance au même titre que le racisme entre humains.
Découvrir des points communs auxquels nous ne nous attendions pas n'aboutit pas forcément à une nouvelle théorie tout aussi limitative qui serait que nous sommes
de ce fait identiques.
En tous les cas, je n'ai jamais voulu dire ça.
On pourrait même découvrir avec certaines similitudes, des différences qui nous mettent sur le cul.
C'est une supposition lancée comme ça. Il y a trop de diversités au niveau des espèces pour faire un schéma Homme VS autres espèces, non ? Surtout qu'en ce qui concerne le fonctionnement humain et ses possibilités rien n'est encore déterminé.
De plus, Chatissimus, le souci du bien-être d'une autre espèce n'est pas non plus l'apanage des humains. Les panthères, Lions et chats qui se sentent sans danger face à un être d'une autre espèce (et voudront jouer) savent rétracter leurs griffes tandis que d'autres vont faire preuve d'une étonnante délicatesse vis à vis des enfants d'hommes ou autres progénitures d'autres espèces. D'après le commentaire d'un reportage paru sur France 5 l'été dernier, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi tant d'espèces différentes adoptent d'autres espèces (une lionne adopte un petit oryx etc...)
Citer:
Dans la nature, où seuls survivent ceux qui sont les mieux adaptés et où l'égoïsme est la principale des motivations, adopter la progéniture d'autres animaux semble en totale contradiction avec la théorie darwinienne de l'évolution !
Et pourtant, chez d'autres espèces, comme les babouins, les dauphins, les goélands, les insectes sociaux et quelques autres, l'adoption est un phénomène régulièrement observé.
En tous les cas pour l'homme on peut déjà remarquer que s'il est conscient à un moment donné de l'exploitation massive avec son lot d'horreurs qu'il génère et sur sa propre espèce et sur d'autres (mémorial de victimes de génocide... en général il semble en être conscient quand c'est déjà trop tard, alors qu'il serait capable de se projeter dans un futur lointain...), il en paraît inconscient à un autre moment ou au même instant et ailleurs. Voir par exemple les massacres "indirects" par la délocalisation des usines d'anti-biotiques occidentales implantées en Inde (j'ai entendu ça aux infos hier).
Conscience de ce que les déchets pourraient produire de nuisible sur leur environnement immédiat, mais "inconscience" dés lors que d'autres en récolteraient les effets toxiques ? Oo.
Une conscience très spéciale qui va faire "oublier" qu'il n'y a ni d'animaux-machines ni d'hommes-machine en réalité...
L'argumentation qui compare l'être humain en tant que prédateur cruel et sans scrupule aux animaux chasseurs ne tient pas la route lorsqu'on se trouve face à un comportement d abattages massifs aussi inutiles dans leur raison d'être que par les souffrances par milliards qu'elles infligent.
Car la robotisation à grande échelle de ce genre de pratique est en elle-même une injure à cette prétendue "loi naturelle" qui ne sert de référence qu'à ce qui nous arrange :
"C'est la nature" lorsqu'on sent qu'on abuse (ton condescendant et enjoué), ce sont de "bas instincts" lorsqu'on se sent abusé (ton horrifié).
Mais d'autres expliquent mieux que moi pourquoi il y a une grosse différence entre une action prédatrice déterminée comme "naturelle" par les animaux et une action prédatrice à grande échelle et systématique qui s'y réfère... par les hommes.
Citer:
Si la prédation et l’entre-dévoration des espèces entre elles à des fins vitales constitue, dans la plupart des cas, une « loi naturelle », la démesure à laquelle nous nous livrons au moyen des modes de production industriels engendre une différence de nature, et non de degré, avec des pratiques de chasse de survie qui comportaient, et comportent encore, pour les populations démunies de ressources alimentaires, un principe de limite. Le fait de tuer l’animal pour s’en nourrir devait conserver un caractère exceptionnel et transgressif, demeurer un acte grave. Ce que, précisément, l’élevage et l’abattage industriels ont balayé comme une superstition, une attitude poétique ou prélogique, non rationnelle, en somme. En pensant que des herbivores pourraient s’accommoder d’une alimentation carnée, on est allé un cran plus loin dans la réduction de l’animal à une machine. N’y a-t-il pas là de quoi méditer sur une agriculture qui a proprement quitté le sol, dérobant aux bêtes l’air et la terre, les rivant au seul temps de l’engraissement dans des bâtiments clos, le corps entravé ?
L'Oubli de l'Animal Florence Burgat. Le MOnde Diplomatique.
ou encore, déjà posté sur ce forum ( l'article entier est
ici) :
Citer:
4. Nature et spécisme :
Il existe un domaine dans lequel l’opinion majoritaire ne peut être expliquée autrement que par l’adhésion à ces deux postulats, bien que ceux qui la partagent en aient rarement conscience. Il s’agit de la définition des êtres dont nous devrions nous soucier (les « patients moraux »). Qui devrait-on « ne pas tuer », « ne pas faire souffrir », « ne pas traiter comme un simple moyen pour parvenir à nos fins » ? Généralement, la réponse est : les êtres humains, alors qu’elle devrait logiquement être : tous ceux pouvant pâtir de ces comportements. Il y a peu de sujets où une « différence naturelle », en l’occurrence d’espèce, est utilisée avec aussi peu de précautions comme frontière morale. Pour ceux que l’on a ainsi exclus, on admet non seulement que leur bien se confond avec « ce que la nature a prévu pour eux », mais on l’assimile au besoin avec ce à quoi ils nous servent : les chats sont faits pour attraper les souris, les moutons pour être tondus et les poulets pour être rôtis.
Y a-t-il donc un ou des caractères naturels qui justifient de façon évidente que l’ensemble des patients moraux se confonde avec l’espèce humaine ? Le simple fait de poser la question est souvent jugé sacrilège. Pourtant, si l’on considère les membres concrets de l’espèce, on a le plus grand mal à trouver un caractère qui soit à la fois exclusivement humain et présent chez tous les humains. Les traits distinctifs généralement invoqués n’appartiennent pas à tous les humains. Ils caractérisent l’humain-type que l’on a établit pour les besoins de la cause. De surcroît surgit alors une seconde difficulté : les traits mis en avant (l’intelligence, la raison, la liberté, le fait d’être « sortis de la nature », etc.) ne semblent pas avoir de rapport avec ce qu’ils sont sensés justifier.
Jeremy Bentham formulait en ces termes les objections que soulève une telle attitude :
« Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n’est en rien une raison pour qu’un être humain soit abandonné sans recours au caprice d’un bourreau. On reconnaîtra peut être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. Et quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu’un enfant d’un jour, d’une semaine, ou même d’un mois. Mais s’ils ne l’étaient pas, qu’est-ce que cela changerait? La question n’est pas : peuvent-il raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? »
(...)
6. En finir avec l'idée de nature, revenir à l’éthique et à la politique
La règle « obéir à la nature » est vide de sens. La « respecter » est du même tonneau : pourquoi respecter ce qui existe, simplement parce que ça existe ? Beaucoup de littérature a été consacrée à prétendre fonder une « réflexion » éthique sur l’obéissance aux lois de la nature, au prix d’amalgames (notamment le glissement illégitime entre deux sens parfaitement distincts du mot « loi », qui désigne soit une régularité soit un commandement), ou sur un « respect » de l’« ordre naturel ». En revenir à cette idée de nature, c’est effectivement un retour à l’ordre, voire, un rappel à l’ordre.
Les idées reçues se propagent en échappant à tout questionnement critique. Mais les propositions creuses ou fausses ne deviennent pas vraies à force de répétition. Elles constituent un danger parce qu’elles offrent une ligne de conduite illusoire ou erronée face à des problèmes bien réels. Les invocations de la nature en lieu et place de principes clairs de jugement comptent hélas parmi les infirmités majeures qui handicapent les mouvements qui voudraient changer le monde pour quelque chose de mieux.
Pour revenir à nos moutons transgéniques ou clonés : le problème n’est pas de savoir si les produits de notre société sont naturels ou artificiels, s’ils « violent des lois de la nature » (s’ils « transgressent des frontières naturelles » comme est censée l’être la frontière d’espèce), mais de savoir si ils sont nuisibles ou non, dangereux ou non, et pour qui. Le problème n’est pas à poser en termes mystiques (une science artificielle industrielle moderne mauvaise qui s'opposerait à une sagesse naturelle artisanale traditionnelle bonne), mais de raisonner en termes éthiques et politiques : quelles sont possiblement les conséquences de notre mode de société, au bénéfice et au détriment de qui ? Où nous mènent-elle ? Qui risque d’en pâtir ? Qu’accepter, que refuser ? Comment changer de cap ?
Les usages programmés des biotechnologies expriment par exemple bien une logique capitaliste qui aspire à rendre toute chose appropriable et dès lors profitable. Les intérêts qu’elles servent sont ceux du profit (et qui plus est du profit d’une classe restreinte), et nullement le bonheur commun, le bonheur de tous. Elles sont un instrument de puissance qui n’est accessible qu’aux puissants ; or, on voit aujourd’hui que les autres types de technologies complexes dont le contrôle échappe complètement aux populations servent des intérêts qui ne sont pas les leurs, et sont aux mains de groupes ou d’États dont l’histoire a clairement montré qu’on ne doit pas leur faire confiance : scandale du sang contaminé ; pollutions radioactives diverses ; accidents à Toulouse, Seveso, Bhopal, naufrages répétés de navires pétroliers, etc., etc.
Mais le problème fondamental ne réside pas simplement dans ces technologies : même les technologies automobiles, par exemple, pourraient sans doute trouver des débouchés utiles dans des sociétés soucieuses des intérêts de tous, bien qu’aujourd’hui elles suscitent des catastrophes massives (innombrables morts et blessés humains ou non, « pollutions » massives, guerres pour l’appropriation du carburant…). Les populations ont pourtant un certain pouvoir d’action à ce niveau, et pourraient refuser le tout-automobile. Elles ne s’en soucient pas le moins du monde. Le problème est bien que nous vivons dans des sociétés de domination et d’exploitation, et que notre conscience est de ce fait une conscience dominée. Dans de telles sociétés, la confiance n’est pas de mise.
Et ce n’est pas l’idée de Nature qui va nous aider : beaucoup de gens ressentent la crise écologique actuelle en termes naturalistes : c’est notre espèce (vue comme groupe biologique) qui poserait problème en elle-même, l’humanité serait en quelque sorte maudite et ne pourrait par essence que « détruire la nature ». Cette façon de poser les problèmes escamote une fois de plus la question des rapports sociaux (c’est bien là le rôle de l’invocation de la nature) : à l’évidence, ce ne sont pourtant pas tous les humains ni toutes les activités sociales qui pèsent d’un même poids destructif sur notre environnement et sur nos vies… Quant à croire que les peuples « premiers », prétendument « proches de la nature », (pourquoi ne pas dire simplement, comme au bon temps des colonies : « peuples primitifs » ou « naturels » ?) pourraient nous aider en nous délivrant une sorte de « sagesse originelle »… Ne serait-il pas plus utile de reparler des rapports sociaux de domination, qu'ils soient capitalistes, patriarcaux ou spécistes ?
Nous préférons hélas soupirer mythiquement après un « âge d’or » ou des « modes de vie traditionnels harmonieux » qui n’ont jamais existé, plutôt que nous battre aujourd’hui et maintenant contre les divers (et nombreux) rapports sociaux de domination, pour l’avènement enfin de mondes qui se soucient des autres mondes, de tous les autres. Eh bien, pourtant, ce n’est pas une fatalité, ce n’est pas dans notre « nature » de persévérer dans des niaiseries dangereuses !!!
Yves Bonnardel, Lyon, janvier 2005
POUR EN FINIR AVEC L'IDEE DE NATURE... ET POUR REPRENDRE AVEC L’ETHIQUE ET LA POLITIQUE